
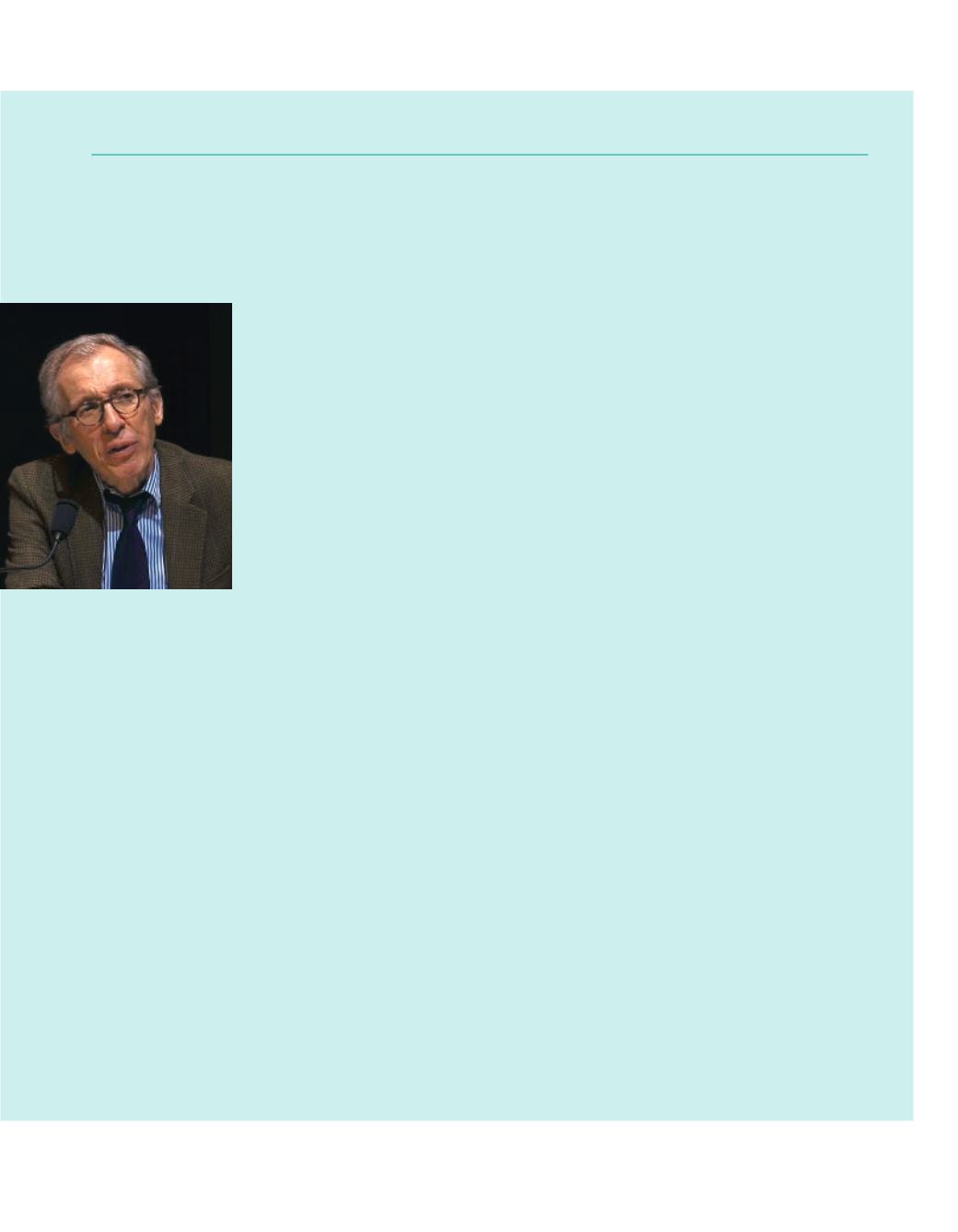
Un musée au service de l’étude des collections - 69
Interview de M. Alain Mérot,
Professeur
d’histoire de l’art
moderne,
Université
Paris-Sorbonne
En quoi
l’exposition
«Poussin et Dieu»
a-t-elle été un
moment important
dans l’étude
de l’artiste ?
Même si la question
de la religion de Poussin
est depuis longtemps
au cœur des réflexions
menées sur le peintre,
le sujet n’avait pas
encore été franchement
abordé, que ce soit
dans le cadre d’un livre
ou dans celui d’une
exposition. Celle-ci
est donc doublement
importante, car elle
a permis de réunir
un nombre important
de tableaux, dont la
confrontation s’est
avérée fort riche,
et elle a donné lieu
à la publication d’un
imposant catalogue
offrant des notices très
fouillées des œuvres
présentées et des essais
rédigés par différents
spécialistes. Le propos
de l’exposition a été
principalement de
réexaminer le rapport
de Poussin à la religion
chrétienne. Elle
a conforté l’idée d’un
Poussin pleinement
chrétien, naguère
défendue notamment
par Marc Fumaroli,
contre l’image d’un
artiste libre penseur,
sinon athée, construite
par Anthony Blunt
et reprise par Jacques
Thuillier. Pour ce faire,
les organisateurs, grâce
à la richesse des prêts
obtenus, ont pu
présenter toutes
les pièces du dossier :
à côté des (rares)
commandes religieuses
proprement dites,
on pouvait voir des
œuvres destinées à tout
un cercle d’« amis
chrétiens » de Poussin.
La diversité des sujets
traités, qu’ils soient
tirés de la Bible
ou de la « fable
mythologique »,
et l’originalité avec
laquelle ils ont été
abordés par le peintre
(avec, vers la fin
surtout, la primauté
donnée au paysage)
font mieux comprendre
sa culture, la façon
dont il a abordé les
textes, mais aussi sa
poétique – sa capacité
à transformer en
images inoubliables
une matière aussi riche.
Votre cycle
de conférences
à l’auditorium a
rencontré un grand
succès. Comment
l’avez-vous conçu
et dans quel but ?
Je n’ai pas voulu,
dans ces conférences
destinées à un très
large public, présenter
de façon classique
« la vie et l’œuvre »
de Nicolas Poussin,
ni redoubler le propos
de mon livre (1990) sur
le peintre. J’ai préféré
faire entrer les
auditeurs/spectateurs
dans son «monde »,
c’est-à-dire montrer
le créateur à l’œuvre et
envisager la spécificité
de sa démarche. Les
lieux qui l’ont inspiré,
la culture dont il s’est
nourri, les étapes de la
composition du tableau
et la traduction
en images de ses
méditations ou de
ses rêveries ont été au
cœur de mon propos.
Le «monde »
de Poussin désigne
d’abord le cadre réel
d’une création : il fallait
donc rappeler les
éléments qui l’ont
constitué. Mais il est
aussi une construction
de l’esprit, tout un
imaginaire auquel
il m’importait
d’introduire. De plus,
il fallait prendre en
compte les trois siècles
et demi qui se sont
écoulés depuis la mort
de l’artiste et faire
sentir au public de 2015
que l’image que nous
avons de Poussin s’est
peu à peu construite
et modifiée au fil
du temps. J’ai donc dû
concilier la pédagogie
du professeur, qui
apporte un certain
nombre d’informations
sûres, et le point
de vue plus subjectif
de l’homme
d’aujourd’hui.
La figure du peintre
a longtemps paru
scolaire, intimidante,
et ses œuvres, érigées
en modèles d’un
certain « classicisme »,
ont souvent été taxées
de sécheresse. Il fallait
donc leur restituer
une vie, une fraîcheur
en substituant au
«peintre-philosophe »
un «peintre-poète »
doué d’une sensibilité
aux multiples facettes.
















