
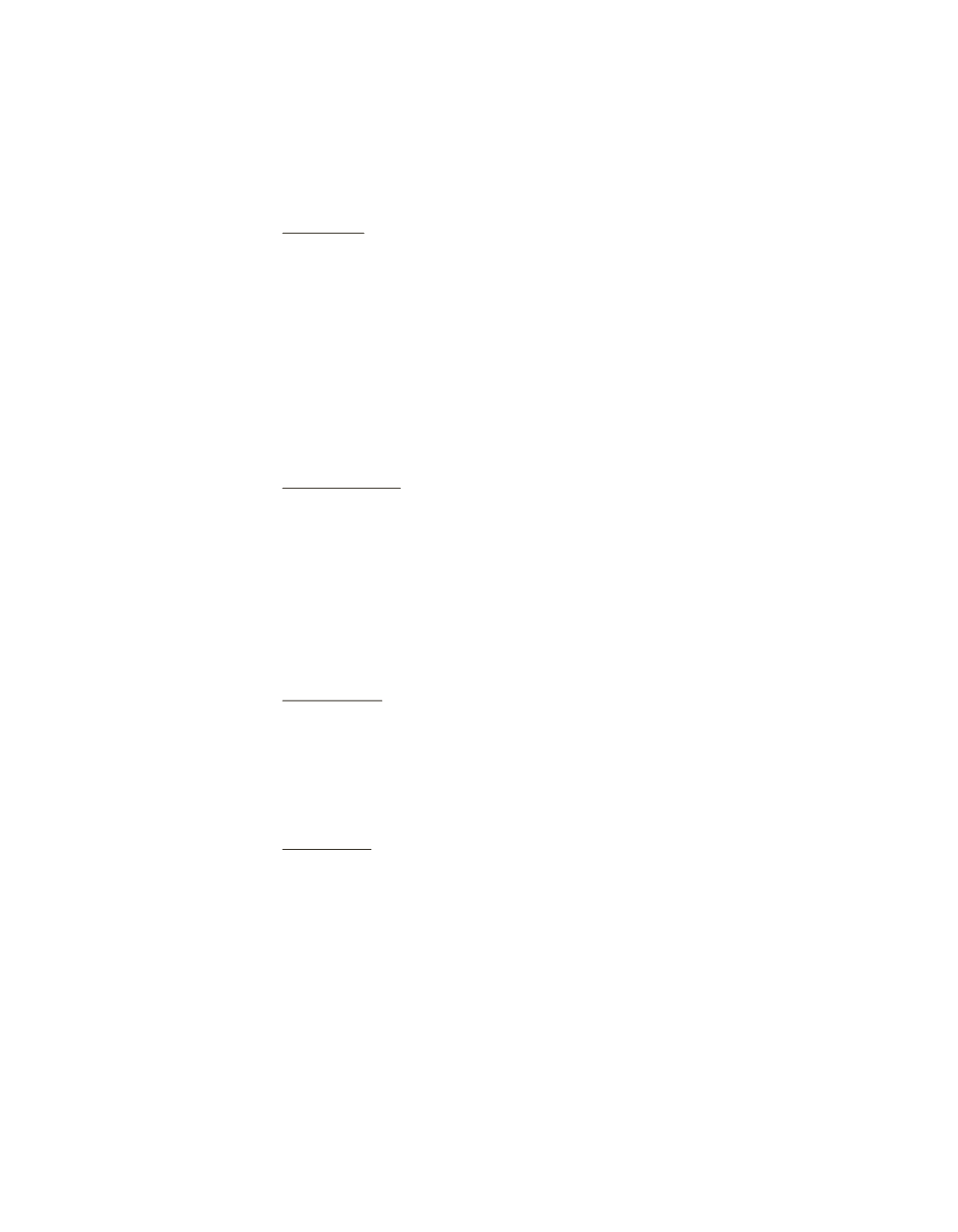
44 - Rapport d’activité - 2015
accueillis. 2 736 œuvres ont été consultées et
étudiées, dont 1200 tablettes cunéiformes dans
le cadre du projet de numérisation “Cunei-
form Digital Initiative Library” (CDIL).
Récolement
Une grande partie de l’année a été consacrée
à l’achèvement du récolement décennal avec
43757 objets récolés dans les réserves. Le réco-
lement est désormais achevé : le département
des Antiquités orientales conserve 151 634
œuvres. Les opérations de post-récolement
seront mises en place en 2016.
Études et documentation
Bases de données
La finalisationdu récolement a permis la pour-
suite de l’alimentationde la baseMuseumPlus,
qui couvre désormais la moitié des collections
du département. Une base de données sur les
archives dudépartement a été créée et alimentée
d’environ 2000 documents. Pour lutter contre
le trafic de biens culturels, une base de données
sur le suivi du marché de l’art a été créée.
Photographies
749 prises de vue photographiques ont été
effectuées. 1 576 phototypes anciens ont été
restaurés et inventoriés. 311 nouveaux dessins
ont été exécutés pour l’exposition «L’histoire
commence en Mésopotamie ».
Bibliothèque
En 2015, la bibliothèque a acquis 160 nouveaux
ouvrages, tout en conduisant divers chantiers
transversaux: accueil des ouvrages de laBiblio-
thèque centraledesmuséesnationaux (BCMN),
groupes de travail duprojetLefuel et nettoyages
de bases liés aunouveau système intégré de ges-
tion de bibliothèque (SIGB).
Les archivesd’AndréParrot (1901-1980), ancien
directeur des fouilles de Mari qui a aussi été
directeur dumusée duLouvre, ont été données
au centre de documentation, lequel a reçu un
don d’ouvrages et d’archives de l’abbé Starcky.
La politique de numérisation des archives
(cartes, fonds Courtois et Delaporte) a été
poursuivie. Le fonds des archives de Roland
de Mecquenem, directeur de la délégation
archéologique française en Perse entre 1912
et 1939, a été traité, analysé et numérisé.
Recherche et enseignement
Le département a coordonné le cours d’his-
toire générale de l’art ainsi que les cours de
spécialité en archéologie orientale à l’École
du Louvre, en plus de l’encadrement de
mémoires de master et de travaux de thèse,
et de divers enseignements hors les murs.
L’accueil et l’encadrement d’une douzaine de
stagiaires d’horizons variés a également per-
mis au département de proposer des actions
de formation de terrain.
Plusieurs projets de recherche pluriannuels
se sont poursuivis ou ont commencé durant
l’année, en particulier la préparation de publi-
cations (stèles puniques de Tunisie, ivoires
d’Arslan Tash, monographie du site de Til
Barsip, corpus des inscriptions grecques et
latines du Proche-Orient).
L’étude des sculptures deMari, dumatériel de
Suse (céramiques de Suse I, métallurgie, ins-
criptions et briques achéménides), de la sculp-
ture syro-anatolienne entre les âges duBronze
et du Fer, des lampes et vases à parfums ont
bénéficié de perspectives nouvelles. Les ana-
lyses scientifiques des œuvres ont été poursui-
vies avec le C2RMF. Ces recherches ont été
valorisées grâce à une vingtaine de commu-
nications et une quinzaine de publications.
Le département a conçu, avec les autres dépar-
tements antiques et le département des Arts
de l’Islam, un « centre des sources écrites »,
réunissant, dans le Palais, les collections des
écritures.
Le département a mis en ligne le site Inter-
net Achemenet
(www.achemenet.com) en
















