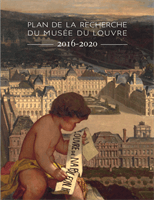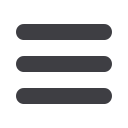
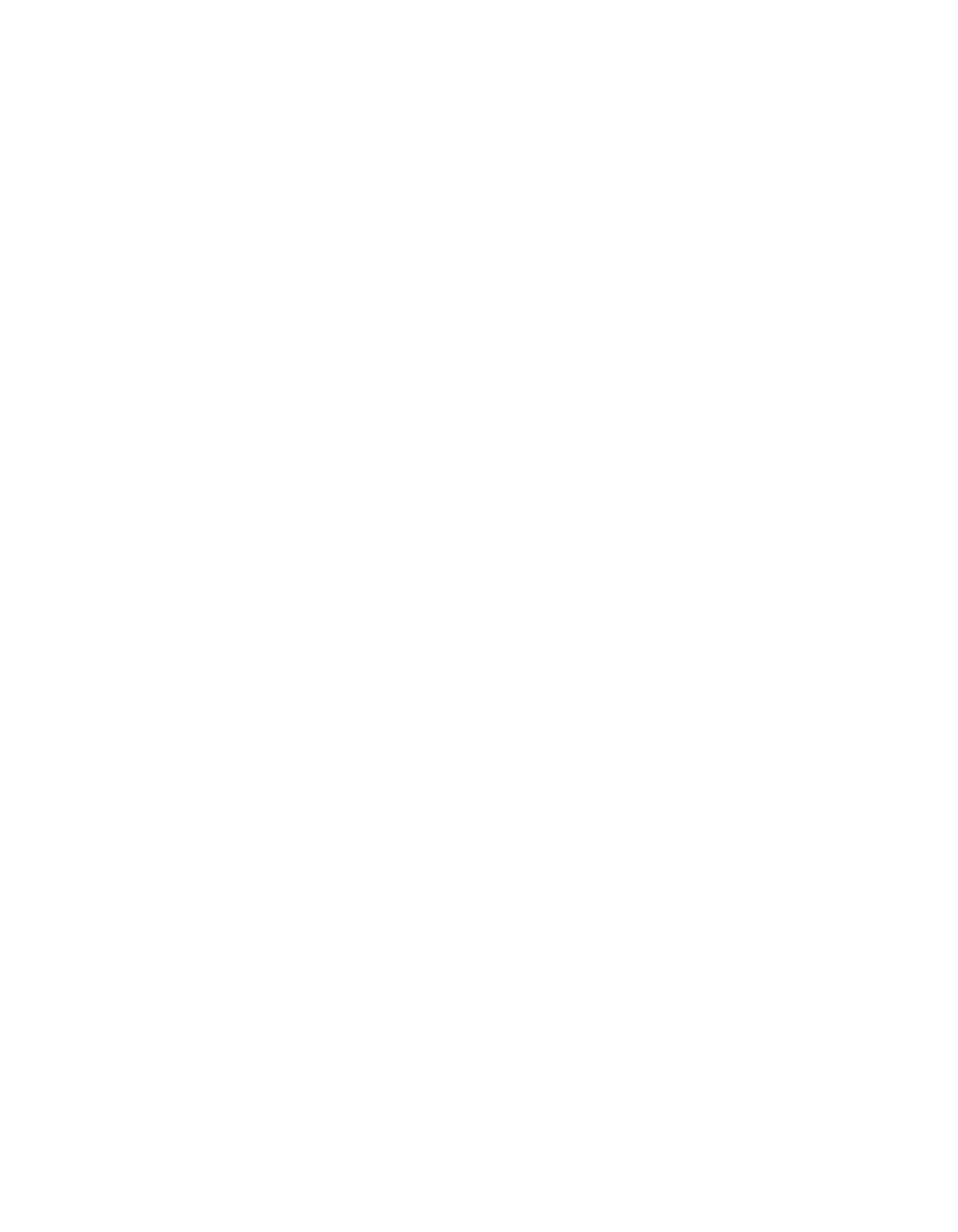
Préfaces
- 7
mot du président
du conseil scientifique
C’est un grand privilège pour les membres du
Conseil scientifique extérieurs auLouvre d’avoir
eu accès à un panorama si riche de l’état de la
recherche aumusée duLouvre. La spécificité de
la recherche dans lesmusées est qu’elle s’élabore
en fonction des collections, des publics et de la
recherche pure. Le Louvre n’est pas un musée
ordinaire. Pour la richesse de ses collections,
ses dimensions, ses qualités et son histoire, il est
une référencemondiale. Montrer l’ambition du
musée dans un tel document et tenter de créer
unmodèle original du rôle de la recherche dans
le musée et d’expérimenter des voies nouvelles
sont des éléments fondamentaux.
Dans les plans de recherche des universités, l’in-
terdisciplinarité est la rhétorique dominante.
Or, dans les musées, les objets eux-mêmes
sont interdisciplinaires. Le public devrait être
sensibilisé à voir directement les œuvres plutôt
que des images.
Le regard que le Conseil scientifique peut
porter sur cette nouvelle phase de la recherche
dans le musée du Louvre est double :
- un regard extérieur de chercheur et de visi-
teur du musée ;
- un regard d’expert issu d’institutions
diverses. Dans ce cadre, il convient de consi-
dérer la recherche selon un double enjeu :
celui de la recherche en général, et celui de
la recherche au Louvre en particulier. Dans
cet esprit, on peut noter qu’il y a plusieurs
façons d’organiser, d’envisager et d’ordonner
la recherche : par département, par axes de
recherche ou encore en transversalité.
Qu’il me soit permis d’insister sur les parcours
transversaux : un projet comme celui de l’ap-
proche épigraphique offre la possibilité de
dresser des parallèles méthodologiques et de
comparer les collections et leur formation ;
l’étude des matériaux papyrologiques donnera
l’opportunité de mieux faire le point entre ce
qui a été publié à ce sujet et ce qui doit l’être.
Je souhaite également souligner par ailleurs
la relation particulière qui s’établit entre les
archives des fouilles passées et les résultats
des fouilles menées actuellement. Ce rapport
n’est pas seulement historique, il est égale-
ment méthodologique et programmatique.
Il est important de comparer les méthodes de
fouilles à différentes époques et d’établir des
modèles de recherche.
Enfin, je souhaite revenir sur un des domaines
particulièrement intéressants et structurants,
celui des études muséales. Il faut effectivement
concevoir le Louvre comme une collection de
collections, et le projet qui porte sur le musée
des Monuments français d’Alexandre Lenoir
est central dans l’histoire de la muséographie
et la réflexion que l’on peut porter sur l’étude
de la présentation des œuvres, de l’histoire du
goût, de la perception que l’on a voulu donner
au public de l’archéologie et de l’histoire de l’art.
Le dynamisme intérieur du Louvre, qui vient
des nouvelles acquisitions ou des nouvelles
fouilles notamment, doit aussi continuer à
s’alimenter de la richesse de ses collections. Ces
collections ne sont pas seulement regroupées
d’un point de vue architectural ou topogra-
phique mais aussi institutionnel. La forme
des collections, leur relation avec les anti-
quaires ou les historiens de l’art sont vraiment
très importantes.
Pour conclure, depuis la création du Conseil
scientifique, les chercheurs du musée ont
montré leur volonté de créer une symétrie plus
accentuée entre les différents départements,
avec une hiérarchisation des différents projets,
et de rendre la transversalité plus explicite. Ce
Plan de la recherche
montre que le dynamisme
de ce musée a plusieurs composantes et naît de
la capacité du Louvre à réfléchir sur lui-même.
Salvatore Settis