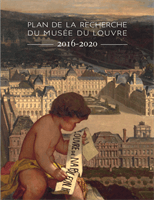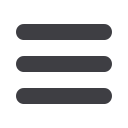
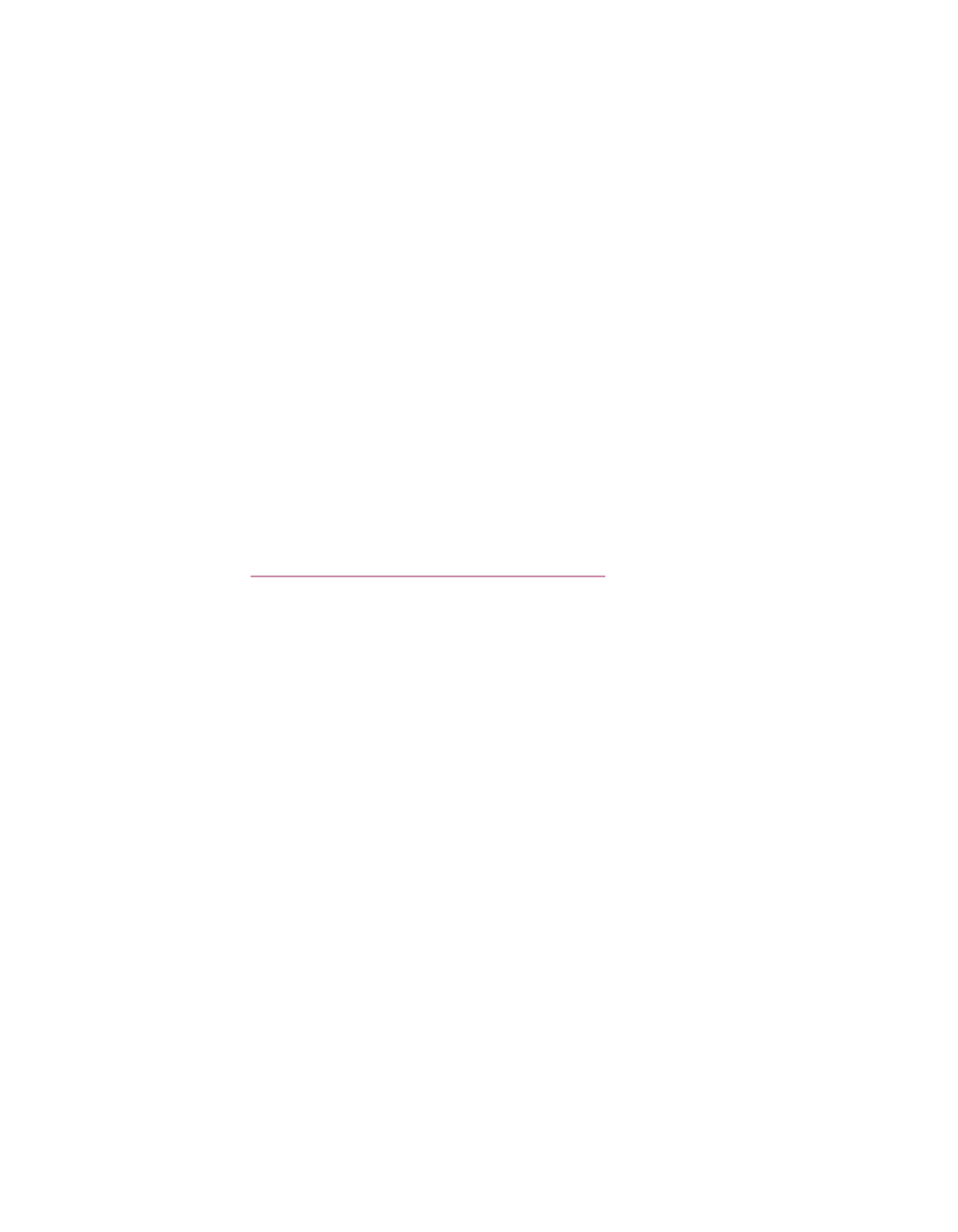
66 -
Plan de la recherche
2016-2020
Le plan de la recherche duDAE prévoit naturel-
lement de s’inscrire dans les trois domaines qui
sont ceux du musée (
Études muséales
,
Études des
collections
,
Études des matériaux et techniques
).
Les grandes rubriques en sont les publica-
tions des catalogues raisonnés des collec-
tions, les fouilles, les recherches transver-
sales au sein du musée et les recherches
faites en coopération avec d’autres institu-
tions, les journées d’études et colloques,
les expositions et la refonte des salles enfin,
aboutissement de la valorisation des résultats
de la recherche.
À noter que cet exercice est celui qui verra la
réalisation du chantier des collections pharao-
niques, commencé au moment où sont écrites
ces lignes, et les premiers travaux en vue du
transfert des réserves vers le Centre de conser-
vation de Liévin. Plusieurs des questions scienti-
fiques posées par la collection, enparticulier celle
de son classement, donneront à la recherche un
rôle de premier plan dans ce chantier.
études muséales
Déjà abordée lors du précédent plan de
la recherche, l’histoire des collections au
XIX
e
siècle (voir plus haut) a donné, entre
autres, la réédition illustrée de la
Notice
descriptive des monuments égyptiens du musée
Charles-X
, établie par Champollion en 1827
(S. Guichard, 2013).
Le répertoire des marques et étiquettes
anciennes portées par les œuvres du dépar-
tement des Antiquités égyptiennes a été
établi et numérisé sous le nom
De numeris
(S.
Guichard et C. Bridonneau).
Le manuscrit d’une
Histoire du département
égyptien de 1848 à 1914
(M. Étienne et S. Sagay)
est en préparation.
Au titre des publications électroniques sera
retenu ici le seul exemple de la mise en ligne
du Registre *7DD10bis (Mariette Sérapéum),
opération qui présente un caractère d’urgence
et demande à être réalisée dans les premières
années de l’exercice.
Pour cet exercice à venir, c’est la refonte des
salles et les futures présentations muséogra-
phiques qui refléteront l’aboutissement de la
recherche : la diffusion des résultats auprès du
public trouvera son application directe dans
le cadre de la refonte des salles programmée
pour débuter en 2018.
Quatre exemples illustreront cette démarche :
- premier millénaire av. J.-C., l’Égypte dite
de la « Basse Époque » a été le parent
pauvre de l’inauguration de 1997. Le projet
actuel entend renverser cette situation avec
une refonte de la muséographie des salles
Charles-X qui seront entièrement consacrées
à cette période (de la fin des Ramessides à la
fin du royaume ptolémaïque) ;
- projet Sérapéum : plusieurs étapes sont
prévues dans le cadre de ce projet, le choix
d’un espace spécifiquement dévolu à la
présentation du site ainsi qu’aux fouilles
de Mariette, à travers la très riche collec-
tion que le Louvre doit à ce dernier ; les
découvertes récentes dans les archives de
Mariette avec leur mise en ligne (voir plus
haut) ; les restaurations de la Porte et des
stèles du Sérapéum ; les études poursuivies
en collaboration avec le C2RMF et la MOM
sur le corpus de 1 000 statuettes de bronze
orientations de la recherche
pour les cinq prochaines années